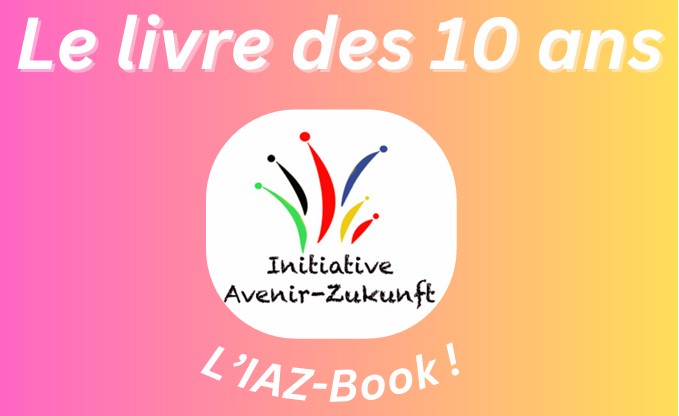Un exemple d’engagement en Allemagne avec l’Initiative Avenir bilingue
Pour les familles et communautés francophones qui vivent dans des pays non francophones l’accès des enfants à une scolarité bilingue est souvent une priorité, voire une condition d’installation. C’est globalement un enjeu majeur pour les mobilités internationales. Faut-il rappeler l’importance de l’apprentissage des langues et de la promotion du patrimoine linguistique mondial ? Considérant en particulier la lenteur des processus d’ouverture de classes ou de création d’écoles bilingues, on a toutes les bonnes raisons de la rappeler ! En Allemagne, une association s’est constituée en 2015 afin de contribuer au développement de filières interculturelles d’accueil de la petite enfance et d’enseignement bilingue franco-allemand.
Le contexte scolaire et préscolaire bilingue
Le système local
Le système scolaire allemand, public ou privé, fait une place très satisfaisante à l’apprentissage des langues et, notamment dans les grandes villes, des cours de français sont dispensés en classes élémentaires et secondaires comme matière principale pour le baccalauréat, donc avec une finalité diplômante, mais pas dans chaque lycée, ni chaque arrondissement. Le recul du nombre d’apprenants du français est cependant sensible, à un moindre degré toutefois que la chute de l’apprentissage de l’allemand en France. La tradition franco-allemande des jumelages, des échanges scolaires et visiblement des vrais projets concrets, perd de sa vigueur malgré des enjeux politiques constamment réaffirmés. La souveraineté des Länder allemands en matière éducative, leurs différentes approches de l’apprentissage des langues font apparaitre des disparités. Le partage d’expériences des politiques menées localement ne se fait qu’au sein de la conférence fédérale des 16 ministres de la culture et de l’éducation, organe de concertation sans compétences décisionnelles.
Le système français hors de France
Le dispositif d’enseignement à la française du réseau de l’Agence pour l’enseignement français à l’étranger (AEFE) opérateur principal sous tutelle du ministère de l’Europe et des Affaires étrangères, est très présent outre-Rhin, avec 16 établissements à Munich, Francfort-sur-le-Main, Fribourg, Stuttgart, Heidelberg, Bonn, Sarrebruck, Düsseldorf, Hambourg et bien sûr Berlin. Différents types d’établissements coexistent dans la nomenclature AEFE : les établissements en gestion directe (Berlin, Francfort, Munich), des établissements conventionnés et partenaires dont certains n’assurent que le niveau élémentaire. En 2024, l’ensemble de ces établissements regroupait quelque 7 500 élèves. La France propose en outre depuis 2012, sous conditions, le label FranceEducation à une trentaine d’établissements scolaires locaux en Allemagne (chiffres 2024, ambassade de France en Allemagne) dispensant un enseignement du français (653 dans le monde). De même, le dispositif ministériel FLAM-Français langue maternelle, géré également par l’AEFE, assure-t-il une offre périscolaire de qualité dans quelques secteurs (Bavière, Hesse, Berlin), à la marge, offre déléguée juridiquement sous une forme associative.
La particularité berlinoise
Berlin se distingue à plus d’un titre dans ce paysage du fait de son histoire contemporaine et de son développement. La ville a créé en 1991, alors qu’elle redevenait capitale de l’Allemagne, un modèle scolaire bilingue unique, public et gratuit : l’École publique européenne de Berlin, la Staatliche Europa-Schule Berlin (SESB). Cet archétype est né dans les années 80 de l’engagement pédagogique de parents et d’enseignants français, et de leur travail bénévole. Il est le fruit d’une réflexion approfondie autour des besoins des enfants et d’une conception pédagogique au bénéfice du plus grand nombre. À l’origine, cette offre scolaire bilingue élémentaire et secondaire concernait les langues des Alliés – l’anglais, le français et le russe – avec six “filiales”, mais aujourd’hui, ce sont neuf combinaisons linguistiques dans 34 filiales avec en outre : l’espagnol, l’italien, le grec, le polonais, le portugais et le turc (le turc s’imposait dans le contexte migratoire de la ville depuis les années 60). Le concept est une école avec un profil pédagogique particulier pour les jeunes Européens, y compris – il faut le souligner encore aujourd’hui pour les mémoires défaillantes – les germanophones puisqu’il y a parité des publics, des langues et des enseignants. L’intégration sociale et culturelle fait l’essence du modèle SESB, modèle qui est malheureusement freiné dans son développement malgré ses excellents résultats aux évaluations.
Avant l’école
Le concept d’école maternelle n’existant pas en Allemagne les structures d’accueil préscolaires sont les jardins d’enfants, « Kindertagesstätte » ou « Kindergarten » appelés couramment « Kitas », comprenant crèches et garderies. Ces structures d’accueil bilingue de la petite enfance (1-6 ans) complètent utilement le dispositif, à Berlin et dans beaucoup de villes, surtout frontalières, par exemple en Sarre ou dans le Palatinat. Les origines remontent à 1840 et au pédagogue Friedrich Fröbel1. Également très en pointe dans le système social en RDA les Kindergärten ont essaimé sur tout le territoire mais nonobstant cette honorable réalité pédagogique il nous est apparu qu’un effort supplémentaire devait porter sur ces structures de la petite enfance qui proposent justement le bilinguisme. À Berlin, ces jardins d’enfants franco-allemands sont plus de 20 (avec en plus la maternelle de l’École française Voltaire) parmi les quelque 2 300 que compte la ville, et 30 avec les groupes de Brême, Hambourg, Hanovre, Leipzig, Magdebourg, Rostock,… accueillant plus de 900 enfants. Ce sont des structures publiques pour certaines, mais la plupart sont de droit privé, souvent des associations à gestion parentale. Une vingtaine de groupes ont rejoint le label Écoles maternelles-Élysée-Kitas-2020 issu de la charte de qualité franco-allemande de 2013 qui fixe des objectifs ambitieux.
L’association
En 2015, l’idée de l’Initiative Avenir bilingue-bilinguale Zukunft (IAZ, pour Initiative Avenir et sa traduction allemande « Zukunft ») était de créer une dynamique favorable à l’extension de l’offre préscolaire et scolaire – avec du français – tant pour le développement des offres bilingues publiques que pour l’affermissement de l’offre d’enseignement à la française autour de l’École française Voltaire et du Lycée français, mais aussi en Allemagne du nord dans les villes dotées de Kitas bilingues. Unifiant ces Kitas – qui conservent toute leur indépendance – autour de nos projets nous avons ainsi constitué un réseau de partenaires sans précédent au service du bilinguisme.
Dès 2014, nous avons invité ces groupes à la Maison de France à Berlin, avec le soutien du service culturel de l’ambassade de France et de l’Institut français. Des visites de Kitas nous ont permis de nous faire connaitre auprès d’elles et de les connaître, de les encourager à rejoindre notre réseau. L’association rend des services sur demande ou à son initiative, partage gratuitement des ressources juridiques et pédagogiques, propose des activités, des formations, relaie les offres de recrutement et publie des fiches de présentation des Kitas. Des cycles de rencontres pour les personnels des Kitas leur ont offert un espace de dialogue, ils ont fait progresser les questions de reconnaissance de qualifications professionnelles. C’est grâce à l’IAZ que les différents groupes ont pu s’identifier et se « reconnaître », ce qui nous semblait une condition fondamentale pour échanger les bonnes pratiques.
En 2018, et avec les aides financières de Sénateurs des Français établis hors de France (via la réserve parlementaire), une subvention de la ville de Berlin et de l’Institut français, l’association a initié, conçu, financé et publié par une maison d’édition la traduction en français du « Programme2 éducatif de la ville de Berlin pour la petite enfance ». Ce document est l’ouvrage pédagogique de référence pour les Kitas de la ville et constitue une ressource inestimable pour les personnels des structures d’accueil (directions, éducateurs et éducatrices, parents gestionnaires) car il leur garantit un accès au cœur du modèle et aux dispositifs d’expertise éducative en français. Nous souhaitions que les équipes dans les Kitas et dans les instituts de formation s’en saisissent pour faire avancer les échanges sur la compréhension des termes, des valeurs et des voies du partage d’expériences. Une collaboration avec l’École santé sociale sud-est/Ocellia de Lyon et la Maison sociale Cyprian les Brosses à Villeurbanne a conféré à ce projet sa dimension bilatérale. Une belle contribution interculturelle franco-allemande, et au-delà, pour la francophonie ! Une version anglaise de ce programme éducatif existait mais personne n’avait auparavant songé à une version francophone ! Pourquoi ?
Le travail de l’Initiative Avenir bilingue-bilinguale Zukunft n’était pas et n’a jamais été une simple addition de prestations, mais, comme d’autres, nous avions fait le constat que la demande de scolarisation bilingue à Berlin augmentait et dépassait les capacités de l’École Voltaire et des quatre filiales primaires franco-allemandes de l’École Publique Européenne de Berlin, il nous fallait donc agir, dans le cadre de la coopération franco-allemande. Or, le constat est toujours le même : l’offre actuelle d’enseignement bilingue souffre de déficits structurels et fonctionnels, déficits provenant de la méconnaissance des dispositifs existants par ceux-là même qui les régissent et dans la faiblesse de la mobilisation des politiques publiques, ce qui provoque des blocages administratifs majeurs et une sous-dotation budgétairedans un contexte financier plus que contraint. Tendances fatales ! Fatales pour les enfants qui risquent de perdre une de leurs langues maternelles dans leur apprentissage, fatales pour les familles qui désespèrent de trouver une place dans une Kita ou une école avec une offre bilingue, fatales au bout du compte aux progrès que chacun appelle de ses vœux dans la coopération franco-allemande et européenne d’aujourd’hui.
Si nos contacts réguliers avec des écoles berlinoises, des maires et des conseillers d’arrondissement, l’administration des services éducatifs de la ville-État de Berlin, le poste diplomatique, les partenaires associatifs et institutionnels se sont parfois avérés peu encourageants nous sommes toujours optimistes, nous avons pratiqué et pratiquons la politique des petits pas, quand d’autres reculent ! Ainsi, l’IAZ a également cherché à trouver des écoles primaires pour la continuation du parcours bilingue commencé dans les jardins d’enfants. Les opportunités ont été rares et n’ont donc pu aboutir à l’ouverture de nouvelles classes franco-allemandes à l’est et au nord-est de Berlin où le sous-équipement scolaire bilingue est cruel malgré prises de contact, visites, entretiens… et surtout malgré la présence croissante de familles franco-allemandes. Il est clair que le fait d’avoir un cursus bilingue complet dans un quartier (jardins d’enfants, école primaire, école secondaire) dope son attractivité et que l’absence d’une telle offre de proximité ne permet pas aux parents et aux équipes pédagogiques de s’y retrouver. Dans une ville huit fois plus étendue que Paris les familles d’aujourd’hui éprouvent des difficultés à envoyer leurs enfants (pour les plus grands) dans un établissement éloigné à 40 minutes de transports en commun, quand bien même elles auraient obtenu une place.
En outre, la ville de Berlin a supprimé les classes enfantines des cursus primaires ce qui a affaibli les conditions d’accueil des jeunes enfants en situation de bilinguisme dans leur première année de scolarité alors que, parallèlement, il avait été question de créer des « Kitas européennes » pour faciliter en amont ce relai avec les écoles primaires de quartier, mais le projet est resté, hélas, dans les tiroirs. Le contexte est difficile aujourd’hui dans les grandes villes du fait de la pression foncière, de la pression démographique dans certains quartiers encore mal desservis – et il serait important que l’arabe soit pris en compte dans les apprentissages – c’est pourquoi, comme dans les années 80, des parents francophones se mobilisent à nouveau pour l’ouverture de classes bilingues franco-allemandes. C’est chose faite dans un lycée, le Diesterweg-Gymnasium où depuis deux ans, grâce à l’engagement de sa direction, un cursus secondaire franco-allemand se met progressivement en place, dans un quartier socialement fragile. Il n’y a que des avantages : accueillir les francophones fortement demandeurs, accueillir pour les intégrer les élèves du quartier issus d’autres communautés, offrir l’accès au français, et en l’espèce au latin, pour faire de ce lycée un lieu d’excellence pédagogique pour tous. Notre initiative a soutenu ces parents et a contribué à leur reconnaissance par les pouvoirs publics en les mettant en responsabilité. Rien ne se fait ni ne se fera sans l’engagement des parents !
Si des projets associatifs peuvent être aisément menés en partenariats et même soutenus, il faut au monde associatif des interlocuteurs décisionnaires pour écouter les propositions, en discuter et pour mettre en œuvre des projets, voire de véritables décisions de politique éducative. En ce domaine comme dans d’autres, « point n’est besoin d’espérer pour entreprendre, ni de réussir pour persévérer », selon Charles le Téméraire, Duc de Bourgogne.
Philippe Loiseau, juin 2025
+ lien document annexe (30 pages)